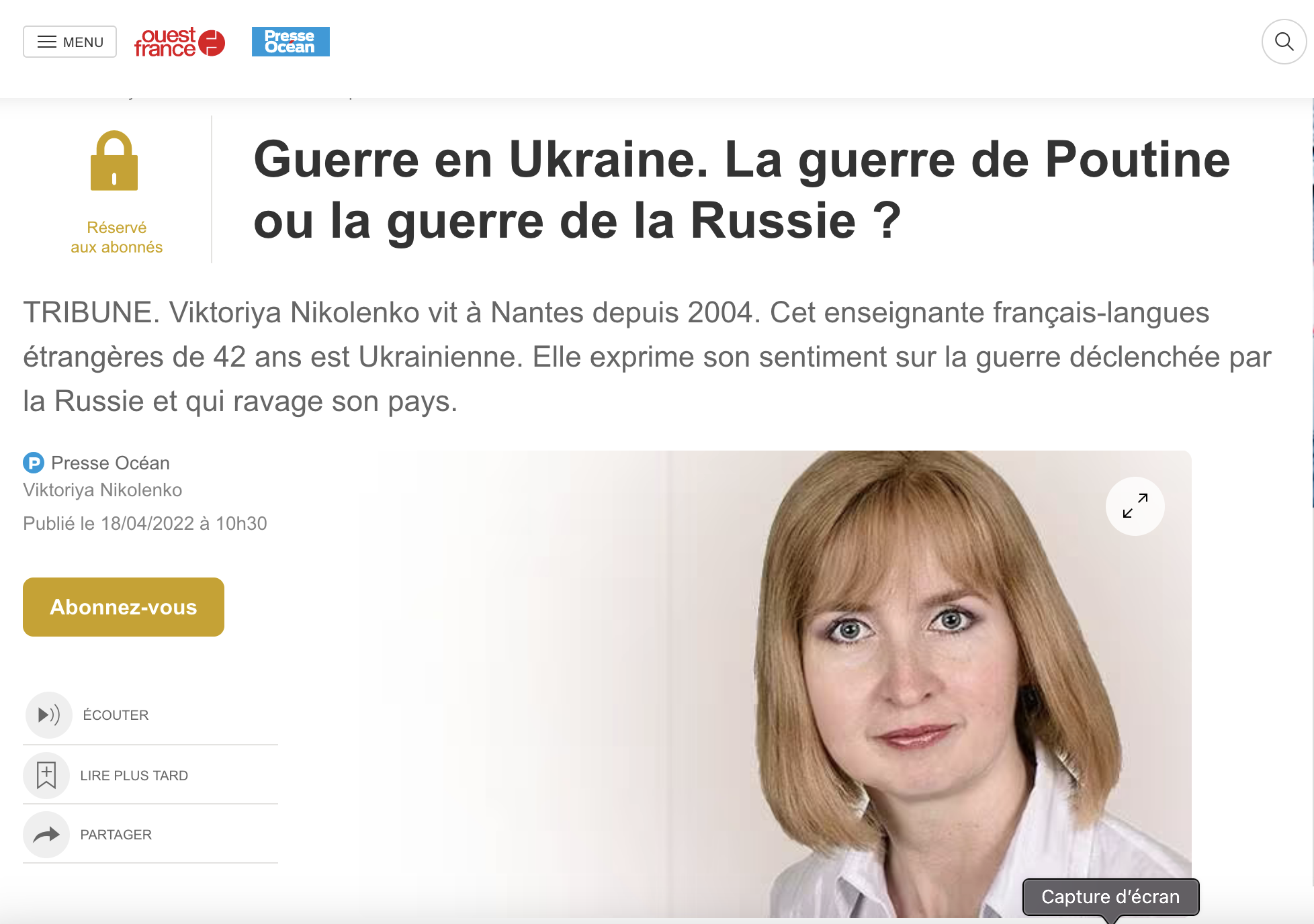Ce texte a été publié pour la première fois le 3 avril 2022 sur mon blog sur Medium.
La version courte de cet article a été aussi publiée le 18/04/2022 dans Presse-Océan — Ouest-France
On dit souvent qu’il faut séparer le dirigeant et le peuple, que la guerre en Ukraine, c’est la guerre de Poutine, alors que les Russes ne la soutiennent pas et en souffrent, et donc il ne faut pas mettre en place les sanctions économiques, boycotter les spectacles et les festivals russes. On dit qu’en Russie il est dangereux de s’insurger, car les répressions sont fortes, les gens ne peuvent pas s’exprimer librement, etc., etc., etc.
Il y a du vrai et du faux dans tout ça, et beaucoup plus de faux que de vrai.
Examinons les choses dans l’ordre.
En 1991, avec la chute de l’URSS les institutions soviétiques vivaient une crise profonde et leur état était à peu près le même dans les quinze républiques devenues États indépendants. Chacun a fait son choix. Par exemple, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont rapidement choisi la voie européenne et ont réussi ce parcours brillamment.
L’Ukraine mettait en place une politique « multivéctorielle » — ni trop pro-occidentale, ni trop pro-russe. Tel un partenariat multilatéral et une neutralité très équilibrée. Les années 1990 étaient très dures économiquement pour tout l’espace post-soviétique, et nombreux étaient ceux qui regrettaient la fameuse « stabilité » d’avant. Néanmoins, habitués à se débrouiller sans trop compter sur l’État et surtout sur le pouvoir central, les Ukrainiens ont petit à petit reconstruit leur pays, et progressivement les choses évoluaient. Malgré les quelques nostalgiques de l’URSS, la majorité des Ukrainiens n’ont jamais regretté leur indépendance, et souriaient face aux répliques de leurs voisins russes qui leur disaient avec un mépris mêlé d’agacement: « Alors, qu’est-ce qu’elle vous a donné, votre indépendance ? Vous êtes des gueux maintenant ! Arrêtez ces bêtises et revenez, rejoignez-nous, on vivra comme avant. C’était bien, non ? » Et bien, non justement. Ce n’était pas bien avant, et personne en Ukraine ne voulait retourner en arrière. Mais pour les Russes, l’indépendance de l’Ukraine n’était qu’une incongruité à réparer tôt ou tard.
La Russie a vécu le changement de statut comme un chaos, et surtout vers la fin du règne de Yeltsine, de plus en plus de russes regrettaient le manque d’une « main forte », d’un « vrai chef d’État ». Les mots « démocrate » et « libéral » étaient des insultes, tout comme de nos jours l’expression « les valeurs européennes » en russe a acquis une très forte connotation péjorative. « Avant, tout le monde avait peur de nous, et maintenant il n’en reste rien ». Et puis, en 1999, l’opération « successeur » a eu lieu. Yeltsine quitte le pouvoir, Poutine est littéralement amené par la main d’abord au poste du premier ministre, ensuite il devient président du pays. Ces élections ne sont qu’une simple formalité : le résultat est connu d’avance. Je me souviens très bien comment il était acclamé et soutenu à l’époque. Par tous, sans exception. Des anciens communistes et KGBistes aux étudiants rebelles. Les jeunes et les retraités, les intellectuels et les femmes de ménage — tous le soutenaient. Rares étaient ceux qui disaient : « Attention, il est KGBiste. Les services secrets, c’est bien, mais il est dangereux d’élire un chef d’État KBGiste. » On leur répondait: « Arrêtez, vous êtes des paranos ! On aura un agent secret comme président, c’est cool ! Et puis, il est jeune, sportif, il parle allemand, un vrai superman ! »
Ensuite surviennent les événements qui auraient dû alerter. La gestion de la tragédie du sous-marin « Koursk », les explosions dans les immeubles d’habitations effectuées par FSB et faussement attribuées aux « terroristes tchétchènes », Beslan, Nord-Ost, les assassinats des journalistes, les restrictions des libertés, les répressions contre les opposants, les élections truquées, la corruption, les tortures dans la police russe, etc., etc., etc. Il n’y a eu presque jamais de protestations, à part quelques rares manifs. À chaque fois cette politique mise en place très progressivement était justifiée. Au pire on disait : « Ok, c’est pas génial, mais il y a bien des raisons pour ça ! Il faut qu’il y ait de l’ordre, sinon c’est le chaos, comme aux 1990. On ne veut plus revivre ça ! » Les recettes confortables provenant du commerce du gaz et du pétrole étaient un gage de sécurité en plus. Ce contrat social arrangeait tout le monde en Russie: on vit mieux que « ces gueux les Ukrainiens », mais on se tait. Et c’est le chef qui décide. Un homme fort. Un vrai. Celui qui nous rendra la grandeur d’avant.
En Ukraine, c’est différent. Pas de rente étatique pour tous, alors il faut se débrouiller. Ce système D était cultivé depuis toujours, malgré les exterminations vécues tout au long du XXe siècle. En Russie les sols ont toujours été beaucoup moins fertiles, et le seul moyen de survivre, c’était de s’unir en communauté, pour mutualiser les risques. En Ukraine, pas besoin d’être intégré à une collectivité. Chacun a suffisamment de ressources pour survivre et il tient à son indépendance. Ma maison, mon jardin, ma parcelle de terre, mes animaux, mes outils de travail, ma petite entreprise. C’est à moi, et rien qu’à moi. Je ne cherche pas à mettre la main sur les biens d’autrui : je me débrouillerai pour produire ce qu’il me faut. Mais je ne lâcherai jamais ce qui est à moi. Un individualisme qui parfois rend aussi un mauvais service… Ces franc-tireurs indépendants n’ont pas besoin de directives d’un chef pour décider de leur sort, et même quand il y en a un, ils sont toujours assez exigeants et critiques envers lui, une longue tradition venant des temps de Hetmanat et de l’État des cosaques, il y a 300 ans. « Là où il y a deux Ukrainiens, il y a trois hetmans » (NDA: le hetman, c’est le chef élu des cosaques au XVII-XVIII siècles).
Tous les présidents ukrainiens étaient très sévèrement critiqués. En trente ans, on en a eu six. Un seul a réussi à se faire réélire. Deux d’entre eux n’ont pas pu aller au bout de leurs mandats : élections anticipées pour Kravtchouk et la fuite de Yanoukovitch pendant le Maïdan de 2014. Deux révolutions : Orange en 2004–2005, pour exprimer le désaccord avec les résultats des élections et les fraudes massives, et Maïdan en 2014. Et cela sans compter de nombreux mouvements protestataires et les grèves.
À chaque fois, le regard sceptique et les remarques humiliantes des voisins russes : « Mais quand est-ce que vous allez vous calmez enfin ? », « Ça suffit, arrêtez vos manifs, allez travailler ! », « Comment osez-vous défier vos dirigeants comme ça ? », « Mais vous ne pouvez pas vous tenir tranquilles ? Regardez les Biélorusses : ils sont calmes et ils vivent bien ! ». Même les plus libéraux discouraient : « Vous faites des révolutions tous les dix ans, mais au fond rien ne change ! Votre pays est toujours aussi corrompu. Vous savez comment on dit : arrêtez de voler sur les pertes, volez au moins sur les recettes ! (un mot d’esprit de Mikhail Jvanetskii repris par Léonid Parfionov) ». Toujours en positions de donneurs de leçons, alors que la Russie est un des pays les plus corrompus au monde, et, si l’on considère le niveau de vie dans la province, pas si prospère que ça.
Ceux qui disent que l’Ukraine a toujours été russe se trompent ou mentent. Ce sont deux cultures, je dirais même deux civilisations distinctes. Tout est différent : les habitudes, les mentalités (même si je n’aime pas trop ce terme), la façon d’organiser sa vie, de gérer le pays, de construire les relations avec les représentants du pouvoir et avec les proches, et même la façon de parler russe.
Les Ukrainiens peuvent tolérer la corruption dans leur pays et même en tirer un certain profit. Mais il y a des choses que les dirigeants ukrainiens n’ont pas le droit de faire, et s’ils l’oublient, les Ukrainiens le leur rappelleront avec une détermination ferme. L’une de ces « lignes rouges » — la violence envers les plus vulnérables (l’un des exemples les plus connus est celui des émeutes à Vradiïvka). Et c’est cette même ligne rouge qu’a franchi Yanoukovitch en 2013 : les milices ont battu cruellement les quelques dizaines de jeunes lors d’une manifestation pacifique pro-européenne, et le lendemain près de 100 000 habitants de Kyiv sont descendus dans les rues. Maïdan a commencé, et rien ne pouvait plus l’arrêter.
La dictature ne s’installe pas du jour au lendemain. Et la liberté n’est pas une chose offerte à un pays et refusée à un autre. Tout se conquiert. Oui, il y en a qui essayent de protester en Russie. Quand les policiers arrêtent un manifestant, des dizaines d’autres filment la scène avec leurs portables, et presque personne ne s’interpose. La police antiémeute ukrainienne en 2013 ne se gênait pas dans ses méthodes non plus. En février 2014, elle tirait sur les manifestants à balles réelles. Mais quand cinq policiers tabassaient un Ukrainien, au moins dix autres se jetaient sur eux pour défendre l’un des leurs. Et ils ne lâchaient pas tant qu’il n’était pas libéré. Parce que la liberté est sacrée. Elle est chantée dans l’hymne national ukrainien, elle est inscrite dans l’armoirie de l’Ukraine (Tryzub), elle est ancrée dans le caractère national et elle fait partie de l’identité même du peuple ukrainien.
Les Russes ont fait leur choix. Ils voulaient avoir un « homme fort » au pouvoir, retrouver la grandeur du passé, avoir le fameuse « stabilité », et ils pensaient avoir retrouvé tout cela, mais au prix de leur liberté qu’ils ont cédée à leur chef, comme d’habitude. Ils ne sont pas otages de cette situation. Ils l’ont voulue et l’ont créée. Leur empire. Avec leur mépris envers les autres — ceux qui ne sont pas comme eux. Leur morgue envers ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. Et leur haine envers ceux qui n’ont pas peur d’eux. Seule la force est respectée, et le respect est interpreté comme une faiblesse. Ce n’est pas de la russophobie, c’est la réalité vécue par moi personnellement et par plusieurs Ukrainiens lors des contacts avec les russes. « Khakhly », « vous n’êtes qu’un État défaillant », « pays 404 », puis on est devenu des « banderites », des « fachos » et des « nazis »… Et maintenant on est bombardé.
Il ne faut pas croire que les Russes ne veulent pas cette guerre. Ils la soutiennent, parce que leur chef leur a dit, et parce qu’« à la télé ils ont dit aussi ». Et même ceux qui se prononcent contre la guerre disent qu’ils sont obligés de la mener parce que sinon l’Ukraine peut les attaquer, l’Ukraine les provoque, et parce que les États-Unis provoquent la Russie à travers leur influence en l’Ukraine — évidemment, les Ukrainiens, ces soi-disant citoyens d’un « failed state » ne peuvent pas agir seuls, il y a forcément quelqu’un derrière. Ils la soutiennent aussi parce qu’ils ne supportent pas de ne pas vivre dans un empire, et les empires, ça dure tant que ça grossit. Dès que l’extension s’arrête, la stagnation et la crise commencent. Et pour grandir au détriment des autres, il faut définir ces autres comme ennemis.
Non, ce n’est pas la guerre de Poutine. La grande majorité des Russes la soutiennent. Ils ont eu plusieurs occasions d’arrêter tout ça, et ils n’ont rien fait. S’ils sont victimes de leur propagande, c’est qu’ils l’ont voulu, parce qu’au XXIe siècle il y a plusieurs façons de trouver une information fiable. Et même si les militaires russes ne pensaient pas être envoyés en Ukraine, ils avaient plusieurs moyens de saboter cette campagne, ou au moins d’épargner les civils, au lieu de les piller, les tuer, violer les femmes et les enfants et s’en vanter devant leurs proches au téléphone (plusieurs communications de ce genre interceptées depuis ces 35 jours de guerre).
Non, les russes ne sont pas des victimes. Mon métier m’a appris à surtout ne pas être catégorique, à analyser la chose sous tous les aspects, à la replacer dans le contexte, etc., etc., mais il y a des moments où tout est clair, comme noir et blanc. Il y a un agresseur, la Russie, et la victime, l’Ukraine. L’agresseur, ce n’est pas Poutine, c’est bien la Russie, à l’exception éventuellement de 1% tout au plus de ceux qui ont essayé de protester. L’agresseur et la victime. C’est aussi simple que ça. Et il est grand temps de comprendre que tant que les crimes de guerre sont commis par les Russes, leur grande culture et leur « âme mystérieuse » n’intéressent personne dans le monde civilisé et démocratique. Donc oui, il faut boycotter les entreprises russes, les institutions et les associations russes, les artistes et les sportifs russes. Ils ont chacun leur part de responsabilité dans ce qui se passe.